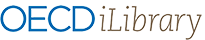Chapitre 12. Capital naturel et durabilité
La notion de « développement durable » occupe aujourd’hui une large place dans le discours des décideurs sur les problèmes d’environnement. Cela constitue l’expression d’un certain nombre de préoccupations (connexes) concernant notamment la trajectoire de développement de l’ensemble de l’économie et, plus particulièrement, la manière dont les richesses naturelles (et leur évolution) affectent celle-ci. Il est important que l’analyse coûts-avantages (ACA) réponde à ces préoccupations, notamment parce que les politiques publiques et les projets d’investissement sont susceptibles de modifier une trajectoire de développement (par exemple en cas d’interventions non marginales ou sous l’effet cumulé de décisions de portée limitée). L’une des implications majeures (et de grande portée) à envisager à cet égard serait de circonscrire l’ACA en la soumettant à des contraintes de durabilité, définies éventuellement sur la base de critères écologiques. L’accent serait ainsi mis plus fortement sur une évaluation unique dans le cadre d’un portefeuille de politiques publiques ou de projets. La contrainte, autrement dit, serait que ce portefeuille aboutisse in fine au maintien du statu quo écologique, et les applications pratiques de cette approche incluraient une « compensation biodiversité ». Cette perspective soulève d’importantes questions. Éviter que des ressources (potentiellement) critiques subissentdes dommages non seulement regrettables mais aussi irréversibles présente certes des avantages, mais l’application de la méthode des projets compensatoires s’accompagne de coûts d’opportunité qui restent à étudier.
12.1. Introduction
Dans quelle mesure les pratiques actuelles d’analyse coûts-avantages (ACA) permettent-elles d’obtenir des informations sur la durabilité des politiques publiques ou des projets soumis à évaluation ? La réponse à cette question dépend évidemment en grande partie de la manière dont est défini le terme « durabilité ». Il peut faire référence par exemple, dans un sens étroit, à la durabilité interne d’un projet au regard des risques de financement et des contraintes budgétaires. Il peut aussi faire référence, dans un sens beaucoup plus large, à toute une palette de facteurs externes – économiques, sociaux ou environnementaux – sur lesquels pourrait influer un projet d’investissement ou une décision des pouvoirs publics. Les objectifs de développement durable (ODD) adoptés par les Nations unies en 2015 illustrent l’ampleur que peut avoir cet éventail de facteurs, puisque ces 17 grands objectifs de développement se déclinent en plus de 160 cibles.
On pourrait considérer que cette ampleur rend nécessaire l’adoption d’une approche multicritères (voir le chapitre 18). Dans certaines applications relatives au secteur des transports, par exemple, la question de la durabilité a été interprétée de cette façon dans une perspective d’évaluation. Dans ce chapitre, cependant, nous retenons une conception plus spécifique de la durabilité, tirée de la science économique, quoique avec des implications interdisciplinaires plus vastes (voir par exemple Arrow et al. 2012 ; CGDD, 2015 ; Hamilton et Atkinson, 2006 ; Helm, 2015). Ses traits distinctifs résident dans l’emploi du terme de durabilité à la fois pour prendre en compte les préoccupations relatives aux générations futures (équité intergénérationnelle) et, en vue de répondre à ces préoccupations, pour mettre l’accent sur l’impact des politiques publiques ou des projets d’investissements proposés sur les richesses (par exemple les perspectives d’évolution du bien-être et des actifs dans une économie, en particulier du capital naturel).
Quelle est donc la spécificité de cette « économie de la durabilité » en termes d’apport à l’évaluation économique ? Au minimum, elle conduit à rapprocher un certain nombre de critiques pertinentes de l’ACA. L’une est le scepticisme à l’égard du principe de Kaldor-Hicks associé à la prescription corrective en vertu de laquelle les interventions qui ont des incidences négatives sur certains groupes (comme les générations futures) devraient s’accompagner de mesures compensatoires effectives. Un autre problème concerne le fait qu’en pratique, il est fréquent que l’approche « marginale » ou « marginaliste » de l’ACA ne prenne pas en compte la durabilité du « système » dans sa globalité (Helm, 2015). Cela peut faire référence aux perspectives associées à la trajectoire de développement d’un système économique. Ces considérations sont également caractéristiques de l’économie du climat (chapitre 14). Dans l’« économie de la durabilité », toutefois, l’accent est mis sur l’influence exercée sur une trajectoire de développement par le point culminant du processus de changement (induit par des politiques publiques ou des projets) de toute une palette de systèmes naturels, communément qualifiésde « capital naturel ».
Pour aborder ces préoccupations, plusieurs voies distinctes se présentent toujours. De fait, on peut considérer qu’il n’y pas grand-chose à redire à la manière dont l’ACA est réalisée, et que l’évolution des connaissances disponibles permet de prendre en compte un certain nombre des problèmes soulevés par ceux qui se soucient de la durabilité. Une telle position n’a rien d’indéfendable. Dans bien des cas, l’ACA est assurément pertinente : l’évaluation des actifs environnementaux, le choix d’un taux d’actualisation et la prise de décisions en situation d’incertitude (future) en sont autant d’exemples.
Ainsi, dans la mesure où une grande part des préoccupations relatives au développement durable se fonde sur l’appréciation des effets induits sur la répartition des revenus, il est d’autant plus nécessaire de rendre compte de la répartition des coûts et des avantages dans le temps. L’appel en ce sens n’est pas nouveau (voir, par exemple, GIEC, 1996) et a été réitéré récemment par Day et Maddison (2015) (voir le chapitre 10). Il est nécessaire d’améliorer la portée et l’exactitude des méthodes d’évaluation – y compris des techniques d’évaluation des actifs environnementaux – utilisées pour mesurer le capital naturel (ou ses variations), au lieu de mesurer simplement les flux de services actuels. Réconcilier l’ACA avec les questions de durabilité pourrait aussi contraindre à déterminer explicitement quelle part de la nature doit rester en dehors du champ de la simple analyse coûts-avantages, et ce que cela implique, par conséquent, pour les modalités d’application de l’ACA.
12.2. Qu’est-ce que la durabilité ?
La question : « Qu’est-ce que la durabilité ou le développement durable ? » est souvent présentée comme une interrogation à laquelle il est impossible de répondre – ou, tout au moins, à laquelle on peut apporter des réponses multiples, éventuellement contradictoires. Or, cela n’aide guère à déterminer comment les praticiens pourraient mieux intégrer le concept de durabilité dans l’ACA. Lorsque, par exemple, la durabilité est définie dans un sens extrêmement large (couvrant « tous » les aspects du processus de développement et des résultats multidimensionnels), comme dans nombre de stratégies nationales de développement durable ou dans les ODD des Nations Unies, l’ampleur de la tâche à accomplir peut être gigantesque. Autrement dit, l’ACA ne permet sans doute pas de couvrir le champ correspondant à ces cadres de vaste portée. En pareil cas, la réaction logique pourrait consister à intégrer ces préoccupations dans l’évaluation en utilisant des outils d’analyse complémentaires pour la prise de décisions (voir le chapitre 18).
Lorsque, en revanche, le développement durable est conceptualisé sous une forme moins globale – éventuellement à partir d’une définition économique de la préservation du bien-être humain (par habitant) dans le temps, qui permette elle-même de déterminer comment gérer les richesses ou les actifs de façon à atteindre cet objectif – l’ampleur de la tâche à accomplir devient plus raisonnable, ou, à tout le moins, il devient possible d’en comprendre plus clairement les implications. Cette approche économique de la durabilité ne permet pas de répondre à toutes les questions, mais elle fournit un point de départ utile pour cerner de manière cohérente le cœur du problème soulevé par le débat sur la durabilité. Ainsi, il est possible d’envisager ensuite les prolongements de ce travail d’analyse.
Les perspectives futures (de développement) dépendent à cet égard des richesses dont dispose une économie. Les projets et les politiques publiques constituent des éléments qui influent sur ces perspectives. Leur impact peut être important ou modeste, mais les projets et les politiques publiques évalués au moyen d’une ACA peuvent être interprétés comme modifiant la trajectoire de développement d’une économie dans le temps (voir, par exemple, Arrow et al., 2003). Ces interventions le font souvent de manière explicite, par exemple en se traduisant par des investissements dans les actifs de l’économie considérée. Parmi les exemples marquants les plus courants à cet égard figurent les projets d’infrastructure matérielle dans le secteur des transports ou des communications, les investissements dans le secteur de l’enseignement public, ou les investissements consacrés à l’amélioration des services de traitement de l’eau et d’assainissement dans une optique de santé publique. Néanmoins, une intervention de ce type peut avoir un effet implicite en créant des ressources (potentiellement) disponibles pour l’investissement, parce qu’elle génère des avantages nets et, partant, améliore les perspectives de consommation future ou de bien-être.
La manière dont les projets et les politiques publiques influent sur le milieu naturel ou physique constitue un autre élément, quoique connexe, à prendre en compte. Ces richesses naturelles comptent pour le développement, car elles constituent en elles-mêmes un déterminant du bien-être futur, dans la mesure où elles fournissent des flux de biens et de services qui permettent in fine aux individus d’obtenir des avantages qu’ils apprécient. C’est pourquoi elles sont de plus en plus souvent désignées par la notion générale de « capital naturel ». De quoi s’agit-il ? Cette expression, bien qu’utile en un sens générique, demande à être définie de manière plus précise pour pouvoir être d’une quelconque utilité aux praticiens de l’ACA. Au Royaume-Uni, le Comité du capital naturel (Natural Capital Committee) définit le capital naturel comme « les composantes de la nature qui (directement et indirectement) sont source de valeur pour la population, comme le stock de forêts, de cours d’eau, de terres, de minerais et les océans, ainsi que les fonctions et processus naturels sur lesquels repose leur existence » (NCC, 2013, p X). Le point commun à ce large éventail de ressources diverses d’origine naturelle réside dans le fait que ce sont des stocks. Il est aussi utile de distinguer d’autres propriétés de ces stocks, notamment parce qu’elles peuvent impliquer des critèresdifférents de prise en compte dans l’ACA (ou, plus généralement, dans les processus de décision d’intérêt collectif).
Certains de ces actifs, tout d’abord, sont non renouvelables. Leurs stocks ont des limites physiques déterminées (même si une certaine incertitude peut exister à ce sujet) et constituent des ressources non vivantes, donc épuisables. Les produits du sous-sol comme le pétrole et le gaz conventionnels en sont des exemples typiques. D’autres actifs, en revanche, sont renouvelables. Il s’agit de ressources vivantes ou de ressources qui se régénèrent (éventuellement à la faveur d’un processus de croissance naturelle ou d’autres processus de régénération naturelle sous-jacents). Une forêt ou un lieu de pêche en sont des exemples que connaissent bien les praticiens de l’ACA. Les actifs écologiques ou écosystémiques constituent une autre catégorie qui suscite une attention grandissante dans les débats sur l’action publique (voir ci-après). Le caractère renouvelable d’une ressource soulève des questions supplémentaires concernant sa gestion. Autrement dit, il est possible de conserver un certain niveau de ressources renouvelables même en les utilisant, ce qui n’est pas le cas pour les ressources non renouvelables.
Qu’est-ce que cela implique éventuellement pour les praticiens de l’ACA ? Ce point présente peut-être un intérêt particulier dès lors que le projet d’investissement ou la politique publique faisant l’objet d’une évaluation se traduira par une perte de capital naturel. Ainsi, pour un capital naturel non renouvelable (en cas de projet minier ou de politique se traduisant par l’épuisement de ressources, par exemple), la question se pose de savoir si des mesures supplémentaires doivent être adoptées (et si oui, lesquelles) pour accompagner ces activités, en vue de compenser cette perte de valeur des actifs considérés. Si cette perte d’actifs porte sur des ressources renouvelables – comme dans le cas d’un changement d’utilisation des terres débouchant sur la dégradation ou la destruction d’écosystèmes – il faudra peut-être, dans une optique de durabilité, se demander si cette perte peut être compensée via l’accumulation d’autres actifs de manière générale, ou si elle rend nécessaire des investissements compensatoires spécifiques dans cet actif renouvelable.
12.3. ACA et « durabilité faible »
Pour décrire le problème que soulèvent les préoccupations relatives à la durabilité pour l’évaluation économique, on peut commencer par établir un état des lieux de l’ACA classique à l’heure actuelle. Stavins et al. (2003) examinent dans cet esprit ce qu’indique l’application du critère coûts-avantages, ainsi que du critère de compensation, et comment l’interpréter à la lumière des préoccupations d’équité intergénérationnelle. Cet examen porte d’abord sur le critère fondamental de Kaldor-Hicks : choisir les propositions offrant une valeur actuelle nette positive (maximale), afin que les gagnants puissent éventuellement offrir une compensation aux perdants tout en restant mieux lotis qu’en l’absence de projet ou de changement de politique. Dès lors que les « gagnants » sont les générations actuelles et les « perdants » les générations futures, on considère que cela indique au moins l’existence potentielle de ressources économiques disponibles pour traiter les problèmes d’équité intergénérationnelle découlant de ces interventions.
En un sens, tout ceci ne fait que réaffirmer la pertinence de la perspective coûts-avantages classique, mais cela établit utilement un lien entre efficience et équité dans le temps et entre générations. Cela soulève, par exemple, la question immédiate de savoir non seulement s’il existe des mécanismes facilitant simplement la compensation entre générations, mais aussi si une compensation potentielle dissipe effectivement le malaise relatif à la question de l’équité intergénérationnelle. On trouve une analyse allant un peu plus loin à cet égard dans une précédente contribution de Farrow (1998), qui soutient que la compensation – dans ce type de situation – devrait être effective et non potentielle. Dans cette optique, il faut commencer par se demander si une proposition d’intervention se traduit par des pertes nettes pour un groupe particulier, en l’occurrence les générations futures. Si tel est le cas, la compensation effectivement offerte à ce groupe particulier doit être au moins aussi importante que ces pertes nettes. Sous l’angle des conséquences que pourraient avoir des décisions actuelles sur le capital naturel, cette compensation doit être au minimum d’une ampleur égale à toute perte de valeur des actifs considérés découlant de la proposition d’intervention. On part ici du principe que la perte de valeur d’un actif entraîne une diminution de bien-être en réduisant les possibilités de consommation futures. Une façon de préserver, au minimum,ces possibilités est d’investir dans d’autres actifs pour compenser ces pertes actuelles.
Ces idées ont joué un rôle dans la genèse de la recommandation pratique formulée par Day et Maddison (2015), par exemple. Ces deux auteurs partent de l’idée que l’ACA offre des informations utiles sur les avantages nets positifs des interventions proposées, qui signalent l’existence de ressources économiques potentiellement disponibles pour l’investissement. Lorsqu’une proposition d’intervention se traduit également par des coûts sous forme de perte de valeur des actifs (parce que le capital naturel est épuisé ou dégradé, par exemple), les gains correspondants peuvent être utilisés pour investir de manière à compenser cette perte, et maintenir ainsi le capital naturel à un niveau constant. Quant à la question de savoir si cet investissement sera réellement effectué, cela dépend naturellement des décideurs. Néanmoins, si ceux-ci croient à l’utilité de l’ACA pour éclairer leurs choix stratégiques, tout en étant déterminés, de manière plus générale, à assurer la durabilité du développement, une évaluation économique permet au moins de mettre en évidence les ressources économiques disponibles pour s’acquitter de l’obligation d’assurer un développement durable.
D’un point de vue pratique, cela laisse à penser que deux éléments d’information pertinents pour l’action des pouvoirs publics devraient être pris en compte conjointement. Le premier correspond au critère classique dans une perspective coûts-avantages : recommander la mise en œuvre des projets ou des politiques publiques évalués positivement à l’issue d’une ACA classique. Le deuxième consiste à déterminer si la totalité des actifs de l’économie est au moins maintenue à un niveau constant. Ce second élément pourrait être évalué à l’aide d’un indicateur de l’évolution de ces actifs. Comme indiqué ci‐après, la mesure de plus en plus employée à cet égard est l’épargne nette ajustée – également qualifiée d’« épargne véritable ». Elle indique l’ampleur de l’accumulation d’actifs nets dans l’économie, ce qui, point important, inclut les variations du capital naturel. Le fait que cette « épargne véritable » soit positive ou non peut fournir des informations sur la durabilité globale des économies dans lesquelles une ACA est réalisée pour des décisions spécifiques.
Ce lien concret entre l’évolution de la richesse totale et la durabilité a été étudié pour la première fois par Pearce et Atkinson (1993). Des études théoriques ultérieures sur la croissance, comme celles de Hamilton et Clemens (1999), de Dasgupta et Mäler (2000) et d’Asheim et Weitzman (2001), ont précisé les fondements théoriques de ce type de mesure de la durabilité. L’idée fondamentale figure cependant dans Hartwick (1977), qui a montré qu’en cas d’extraction de ressources épuisables, la consommation future pourrait être préservée si d’autres investissements compensaient la valeur de l’épuisement de ces ressources. Un investissement minier permettant d’exploiter un gisement de ressources naturelles précieuses mais dont la quantité est finie finance, par définition, une activité non durable. Autrement dit, l’exploitation minière ne peut se poursuivre que jusqu’à épuisement (physique ou économique) des ressources considérées. Les conséquences plus globales de cette activité en termes de durabilité constituent une autre question. Elles dépendent en grande partie du fait de savoir si le produit de l’exploitation de ce gisement de ressources est ou non investi dans un autre actif (productif). Si ces recettes sont réinvesties dans de nouveaux projets productifs, le développement peut s’inscrire dans la durée.
De manière théorique, Hartwick (1977) a montré que des réflexions antérieures importantes sur ce problème (comme celles de Solow, 1974) reposaient sur une règle d’épargne suivant laquelle une partie des recettes (plus précisément, les rentes tirées de ressources naturelles) provenant de l’épuisement d’une ressource non renouvelable était investie dans d’autres actifs. Ceux-ci sont généralement conçus comme des actifs produits, mais il pourrait aussi s’agir de capital humain. Ainsi, le développement – défini comme une trajectoire de consommation constante – peut être perpétué malgré la dépendance à l’égard d’un actif naturel disponible en quantité finie (donc épuisable). Pour ce faire, il faut maintenir à un niveau supérieur ou égal à zéro l’épargne nette totale pour tous les types de capital – autrement dit l’« épargne véritable », pour reprendre le nom donné à ce concept par Hamilton (1994). Solow (1986), quant à lui, a montré que l’application de ce principe se traduisait par une règle de constance du capital. Cet élément est devenu le socle de la réflexion moderne sur l’économie de la durabilité.
Plus récemment, a été élaborée une forme générale de cette « règle de Hartwick », qui présente une caractéristique importante : elle est conciliable avec l’éventualité d’une trajectoire de consommation ascendante. Elle est donc compatible avec un cadre d’action ayant pour objectif la croissance économique, et non simplement une trajectoire de développement économique constant. Hamilton et Hartwick (2006) mettent en évidence une relation entre (les variations de) la consommation et l’épargne nette. Selon cette règle généralisée de Hartwick, une épargne véritable positive peut déboucher sur une trajectoire de développement s’accompagnant d’une croissance de la consommation. Une condition essentielle à cet égard est que l’épargne véritable n’augmente pas plus vite que le taux d’intérêt (c’est-à-dire le rendement du capital produit). Hamilton et Withagen (2007) en explorent les implications de manière un peu plus poussée, et montrent qu’un taux d’épargne véritable positif constant (l’épargne en proportion du revenu national) implique que la consommation peut augmenter de manière illimitée.
Tous les projets qui, toutes choses égales par ailleurs, sont à l’origine d’une accumulation (nette) de capital produit ou de capital humain contribuent donc à la durabilité. En d’autres termes, les débats sur le développement durable dans le contexte de l’ACA doivent prendre en compte le fait, souhaitable, que bien des projets et politiques publiques concourent à accroître la richesse. Bien entendu, si ces initiatives provoquent des dommages environnementaux ou un épuisement des stocks de ressources, cette perte d’actifs naturels a pour effet de réduire la durabilité, toutes choses égales par ailleurs. Comme nous l’avons vu, toutefois, l’effet net en est mis en évidence par des indicateurs synthétiques tels que l’épargne véritable ou l’évolution de la richesse nette par habitant.
Un exemple pratique de ce type d’analyse est évoqué dans l’encadré 12.1. Il illustre l’utilisation de fonds souverains pour gérer les recettes tirées de l’épuisement de ressources non renouvelables (telles que le pétrole et le gaz). Les travaux publiés sur l’« épargne véritable » ont montré qu’il s’agissait d’un des moyens de concrétiser la prise en compte de l’intérêt des générations futures, mais une attention beaucoup plus limitée a été accordée à la productivité des investissements. Il est tout à fait clair que cette dernière question relève de l’ACA. Les projets retenus à la suite d’une évaluation coûts-avantages peuvent non seulement accroître la richesse nette, mais aussi contribuer à assurer un développement durable en garantissant que l’épargne soit consacrée aux usages les plus productifs.
Les ressources épuisables et les revenus qu’elles génèrent présentent deux grands problèmes du point de vue de la gestion macroéconomique : la production brute et les recettes fiscales sont généralement élevées mais extrêmement volatiles ; en outre, le flux des recettes est fini et cesse lorsque l’exploitation du gisement d’une ressource n’est plus rentable. Des flux importants de recettes fiscales provenant de ressources naturelles créent un risque spécifique, à savoir que la politique budgétaire devienne procyclique et constitue ainsi un facteur d’instabilité macroéconomique. De plus, le caractère fini de ces flux de recettes soulève d’importantes questions quant à la durabilité macro économique : le bien être sera t il appelé à baisser une fois la ressource épuisée ?
Divers pays ont décidé de créer un fonds souverain pour faire face à ces risques et tirer parti des opportunités, notamment la Norvège, qui a établi son fonds au cours des années 90. Hamilton et Ley (2011) énumèrent douze pays ou juridictions où des fonds de ressource et/ou des règles budgétaires s’appliquant aux revenus tirés des ressources naturelles ont été mis en place. Le Royaume-Uni fait exception à cet égard, puisqu’il a décidé à la fin des années 70 de ne pas créer de fonds souverain et n’a (semble t il) pas réexaminé cette décision depuis. Étant donné cependant que les revenus de la mer du Nord ont représenté 9.9 % des recettes fiscales et atteint 3.7 % du PIB en 1984, et que ces revenus sont restés supérieurs à 1 % du PIB de 1979 à 1987, on peut raisonnablement s’interroger sur les coûts et les avantages de cette décision.
Pour déterminer le sacrifice probable qui aurait résulté de la création (hypothétique) d’un fonds souverain en 1975, Atkinson et Hamilton (2016) ont réalisé une analyse coûts avantages ex post d’un fonds souverain en tant qu’investissement public. Si les revenus tirés d’une ressource qui sont versés au fonds souverain deviennent des coûts du point de vue du Trésor public, les sommes versées par le fonds au Trésor public constituent des avantages. Dans un but de simplicité, les auteurs présupposent que la ressource pétrolière est épuisée en 2010. Les coûts d’investissement dans le fonds souverain cessent donc à cette date. Ils présupposent aussi cependant que le fonds continue à payer à perpétuité un montant égal au montant versé en 2010 (rendement réel du portefeuille). Le tableau 12.1 montre la valeur actuelle des coûts et avantages de l’investissement dans le fonds souverain, normalisés par habitant, au regard de différentes échéances temporelles et hypothèses concernant le taux d’actualisation.
Pour isoler les effets de la bulle des prix du pétrole et d’autres circonstances économiques du début des années 80, ils calculent les coûts et avantages simulés au regard de deux hypothèses concernant l’année où l’on a commencé à investir dans le fonds : 1975 ou 1990. Avec un commencement en 1975, on obtient une valeur actuelle plus élevée des avantages provenant du fonds, mais aussi une valeur actuelle élevée des coûts, car ces coûts (alimentation du fonds) sont perçus d’emblée. Les montants ainsi perçus sont fortement réduits dans l’hypothèse d’un commencement du fonds en 1990.
Dans la première hypothèse, le taux d’actualisation fixe de 3.5 % est identique au taux d’actualisation social du Green Book 2003 pour les projets dont les coûts et avantages s’étendent sur une période maximale de trente ans. Dans la deuxième hypothèse, le taux d’actualisation utilisé est un taux de 3.5 % mais qui diminue au delà de trente ans. Cela correspond au taux d’actualisation social envisagé par le Green Book 2003 pour évaluer les politiques ayant des incidences à long terme – ce qui est précisément ce que doit absorber un fonds souverain.
Comme le montre le tableau 12.1, la valeur actuelle des avantages tirés du fonds souverain excède celle des coûts de 10 % à 69 % dans l’hypothèse du fonds commençant en 1975. Les chiffres correspondants sont de 11 % et 100 % dans l’hypothèse de la création du fonds en 1990. Les avantages annuels nets (avantages actualisés moins coûts actualisés)
varient entre 14 et 10 GBP par habitant avec le taux d’actualisation fixe, et entre 97 et 88 GBP avec le taux d’actualisation décroissant ; dans tous les cas, le scénario 1990 aboutit aux avantages nets les plus bas. Les résultats du taux d’actualisation fixe sont plus sensibles au choix du taux d’actualisation, un taux d’actualisation de 3.92 % (taux de rendement réel constant présupposé du fonds souverain) aboutissant à 0 avantage net, quelle que soit l’année de commencement. Cet artéfact est produit par le rendement nominal synthétique du fonds souverain dont les auteurs se servent pour simuler le rendement du fonds (qui est, à son tour, basé sur le rendement réel moyen d’un assortiment globalement pondéré d’avoirs détenus sous forme de titres et d’obligations).
La création d’un fonds souverain n’aurait donc pas été sans sacrifice. Cependant, cette analyse ex post laisse à penser que, si le fonds souverain avait été créé en suivant les normes indiquées dans le Green Book 2003, les avantages nets par habitant auraient été positifs et modérément élevés dans l’hypothèse d’un taux d’actualisation décroissant. Point important, cela aurait aussi pu se traduire par la création d’une source durable de revenus à partir de l’utilisation de ressources finies.
Une évolution intéressante réside dans l’élargissement de ce cadre au capital naturel renouvelable. Cela débouche sur au moins deux questions fondamentales. Premièrement, cela exige des progrès en matière d’évaluation des actifs environnementaux, tant sur le plan conceptuel qu’empirique. Deuxièmement, ce type d’élargissement ne va pas sans controverse. L’approche économique de la durabilité décrite ci-avant est souvent qualifiée de « durabilité faible ». Il s’agit d’une dénomination descriptive utilisée pour distinguer cette approche de conceptions plus fortes de la durabilité, mettant bien davantage l’accent sur la préservation du capital naturel sous l’angle des préoccupations intergénérationnelles. En tant que telle, cette dénomination est également prescriptive, ce qui la distingue d’approches qui sont peut-être nettement moins permissives en termes d’orientations données aux praticiens de l’ACA pour gérer le problème de la durabilité. Ces deux questions relatives à l’évaluation du capital naturel et à la « durabilité forte » sont examinées ci-après.
12.4. Évaluer le capital naturel
La terminologie actuelle concernant l’évaluation des actifs environnementaux est axée dans une large mesure sur l’évaluation des flux, c’est-à-dire du flux d’avantages liés éventuellement à la consommation d’un bien ou d’un service. Naturellement, les interventions des pouvoirs publics comme, par exemple, les investissements visant à protéger (ou à améliorer) des écosystèmes ont généralement pour effet de stimuler le flux de ces services dans le temps, introduisant ainsi un élément dynamique dans toute analyse économique. En outre, lorsque ces mêmes écosystèmes sont perturbés par certains changements (que ce soit une modification de l’utilisation des sols ou une dégradation de leur état), l’effet qui en résulte pour le bien-être présente également une dimension intertemporelle (voir, par exemple, Mäler, 2008 ; Dasgupta, 2009). Par conséquent, l’objet de notre réflexion doit être l’actif écosystémique sous-jacent et, en particulier, les variations de la valeur de cet actif résultant des interventions humaines (qu’elles soient positives ou négatives, intentionnelles ou non).
Ces flux de services peuvent donc être considérés comme des flux de « production » fournis par des actifs sous-jacents ou un « capital naturel » (des zones boisées ou des zones humides, par exemple). À la lumière de la section précédente, ce qu’il convient d’évaluer ici, c’est la modification potentielle des perspectives d’évolution future compte tenu de ce qu’il advient du capital naturel maintenant. Cette évaluation peut apporter un éclairage sur la question de savoir si l’utilisation du capital naturel et la trajectoire de développement économique de manière plus générale sont durables ou non.
Ces travaux restent fortement liés aux principes de l’ACA. Cela ressort, par exemple, des études visant à déterminer la durabilité économique en cas de changement d’utilisation des terres, lié par exemple à la déforestation ou à la disparition d’autres habitats naturels comme des mangroves. L’unité de base utilisée ici – selon Hamilton et Atkinson (2006), Barbier (2009) et des contributions antérieures, en particulier celle de Hartwick (1992) – est la terre. En effet, la terre affectée à une utilisation particulière possède une valeur spécifique en tant qu’actif. Lorsque l’utilisation des sols change – comme cela se produit en cas de déforestation – la situation peut être analysée du point de vue de l’ACA : en d’autres termes, le changement se traduit-il par des avantages nets ? En outre, ses conséquences sur l’évolution de la richesse dans l’économie doivent être prises en compte.
En cas de déforestation, la baisse de la valeur des terres boisées s’accompagne aussi d’une augmentation de la valeur des actifs fonciers agricoles. Autrement dit, ce qui se produit est un changement de la composition d’un portefeuille d’actifs fonciers plus large. Si, par exemple, un des services écosystémiques fournis par les terres boisées est la régulation du climat (via le piégeage et le stockage du carbone), augmenter la quantité de terres boisées entraîne une fourniture accrue de ces services. Toutefois, ce processus peut aussi s’accompagner d’une diminution des services de régulation du climat fournis par les terres agricoles et, idéalement, ces services perdus devraient aussi être comptabilisés quelque part. Les terres boisées constituent en outre un actif qui est source de nombreux avantages, et il importe que le plus grand nombre possible d’entre eux soient pris en compte. D’autres problèmes de mesure se posent à cet égard. Il est clair, en effet, que les autres services affectés par le changement d’utilisation des sols doivent, eux aussi, être pris en compte. Un bilan plus général, par exemple, devra refléter la perte de production agricole, et ainsi de suite. On peut aussi supposer que le changement d’utilisation des sols s’accompagne de coûts de conversion, et ces coûts d’investissement devraient aussi être comptabilisés.
Un élément essentiel pour l’intégration de meilleures mesures (de la variation) du capital humain dans l’ACA réside dans l’élargissement du champ de l’évaluation à ce domaine. Les progrès réalisés en matière d’évaluation des actifs environnementaux – particulièrement dans le domaine de l’évaluation des écosystèmes (en termes de services écosystémiques) – sont encourageants. Toutefois, ils sont encore largement débattus et, indépendamment du fait de savoir si l’on considère que le verre est à moitié vide ou à moitié plein, le règlement de ce problème d’évaluation n’est pas encore achevé. S’il est clair, par exemple, qu’un grand nombre de projets de développement ont un impact sur la biodiversité, notamment en modifiant l’utilisation des sols et les habitats naturels, il est loin d’être certain qu’un outil d’évaluation, même de pointe, permette de déterminer de façon adéquate la valeur de cette perte. En conséquence, on peut présumer que l’évaluation du capital naturel offre peut-être un tableau suffisamment complet de ce qui se passe lorsque des projets d’investissement ou des politiques publiques affectent des actifs naturels tels que des écosystèmes (et des actifs sous-jacents comme la biodiversité). Compte tenu de l’appréciation de la capacité des praticiens à relever ce défi, une plus grande prudence s’impose sans doutequant au rôle joué par l’ACA à cet égard (voir la section suivante).
Lorsqu’une évaluation des actifs environnementaux est possible, le problème semble plus simple d’un point de vue analytique, du moins à première vue. Autrement dit, la valeur du capital naturel peut être considérée comme égale à la valeur capitalisée des flux de services futurs. Naturellement, pour de nombreuses catégories de capital naturel (renouvelable) tels que les écosystèmes, les prix des flux de services qui en résultent ne sont pas observés, si bien que les prix des actifs écosystémiques ne le sont pas non plus. Néanmoins, comme l’illustrent divers chapitres de cet ouvrage, les progrès considérables accomplis en matière d’évaluation des actifs environnementaux permettent au moins d’apporter une réponse de plus en plus complète à cette question (voir aussi le chapitre 13). Ainsi que l’illustre l’encadré 12.2, certains praticiens se sont efforcés de transformer ce socle de connaissances grandissant en estimations vraiment ambitieuses de la valeur globale d’un capital naturel en évolution.
L’attention qui se porte depuis peu sur les évaluations d’écosystèmes à grande échelle – par exemple dans le cadre de l’initiative TEEB (L’économie des écosystèmes et de la biodiversité) ou du programme NEA (National Ecosystem Assessment) au Royaume-Uni – signale un intérêt pour la recherche d’indices quant à l’échelle globale – d’un point de vue économique – de ce qui a été perdu (et sera probablement perdu à l’avenir) sous l’effet de la destruction continue du monde naturel. Même si cela ne peut remplacer une analyse de fond plus détaillée, la connaissance de ces tendances pourrait être utile pour encadrer la réflexion sur les politiques. Ce type d’information pourrait aussi aider à comprendre si le recul des écosystèmes et de la biodiversité est un problème de développement, comme l’a montré Stern (2007) par exemple à propos du changement climatique.
Quoi qu’il en soit, on observe des signes manifestes d’un intérêt croissant pour cette question. Les liens établis entre les évaluations (récentes ou en cours) des écosystèmes et les efforts engagés pour comprendre la manière dont l’évolution de la richesse naturelle affecte la durabilité du développement en appliquant les principes de la comptabilité verte dans les comptes nationaux en sont une illustration (voir, par exemple, Banque mondiale, 2010 ; Arrow et al. 2011). Le Partenariat mondial WAVES (Comptabilisation de la richesse naturelle et valorisation des systèmes écosystémiques), dirigé par la Banque mondiale, constitue une application pratique de ce travail dans un certain nombre de pays candidats. On ne saurait douter de la pertinence de tels travaux au regard de la question qui est au cœur de l’approche économique de la durabilité : des ressources suffisantes sont elles conservées pour l’avenir ?
Certaines études ont cherché à traiter ces questions en calculant les pertes d’actifs naturels susceptibles de se produire selon plusieurs scénarios de politiques possibles (et donc en posant en principe une question plus défendable que celle concernant la totalité du flux de services actuel). Hussain et al. (2012) proposent ainsi une estimation des pertes subies dans le passé récent et des pertes que subiront à l’avenir, selon les projections, les écosystèmes aquatiques du monde (spécifiquement les zones humides, les mangroves et les récifs coralliens). La valeur actuelle de ces pertes pendant la période 2000-50 (en utilisant un taux d’actualisation de 4 %) est jugée supérieure à 2 billions USD (en USD de 2007) (les deux tiers de cette somme correspondant aux pertes subies par les zones humides). La valeur annualisée de ce changement total (c’est à dire la valeur estimée des pertes subies par ces actifs écosystémiques chaque année) est légèrement inférieure à 100 milliards USD, ce qui en 2007 représentait 0.2 % du revenu mondial brut. Chiabai et al. (2011) aboutissent à des résultats en partie comparables s’agissant des pertes dues à la déforestation mondiale pendant la même période.
Inutile de dire que de telles estimations mondiales des pertes écosystémiques s’appuient sur des hypothèses et des généralisations que l’on pourrait qualifier d’héroïques (ce qui est vrai également des travaux cherchant à évaluer les impacts mondiaux du changement climatique). Certains auteurs considèrent d’ailleurs que chercher à déterminer une valeur mondiale est un projet vicié à la base précisément pour cette raison. Néanmoins, si l’on prend ces résultats au pied de la lettre, il apparaît que le fait de connaître l’ampleur globale des pertes subies par les écosystèmes ne fait guère avancer le débat empirique. Par conséquent, même s’il est tout à fait possible que de telles analyses négligent quelque chose d’important et de décisif, on est tenté de conclure qu’aussi bien l’exigence pragmatique d’indicateurs de tendances agrégés à un niveau supérieur que le souci de validité incitent à éviter de privilégier les tendances mondiales.
L’échelon régional ou national, en revanche, présente un plus grand intérêt pratique. S’agissant des forêts du Brésil, par exemple, les pertes de richesse naturelle estimées par Chiabai et al. (2011) atteignent un niveau substantiel (en pourcentage du revenu national brut ou RNB). Dans le cas des écosystèmes aquatiques d’Asie du Sud et d’Indonésie, Hussain et al. (2012), constatent que les pertes annuelles de richesse naturelle s’élèvent respectivement à 1.7 % et 4.0 % du RNB (en 2007).
Il serait utile d’en savoir plus sur de tels ordres de grandeur. Cela nécessiterait d’examiner de plus près la solidité de ces estimations. Le problème fondamental que pose le calcul de la valeur des écosystèmes est simple. En effet, ce calcul exige d’identifier un prix ou une valeur (unitaire) et un volume de (variation de la) fourniture de services écosystémiques, par exemple (Boyd et Banzhof, 2007). La difficulté immédiate, cependant, est de déterminer dans quelle mesure probable les données empiriques disponibles au sujet des « prix » et des « quantités » écosystémiques peuvent être étirées et appliquées à des aires écosystémiques disparates pour aboutir à de solides généralisations. La variabilité spatiale est ce qui est en jeu ici. Il est nécessaire de prendre en compte de manière adéquate la variation des caractéristiques de l’offre des écosystèmes – type et étendue des fonctions – et des caractéristiques de la demande, à savoir celle de la population humaine qui consomme les services résultant de ces fonctions. Tout cela requiert une cartographie assez sophistiquée et une masse d’informations. Il se peut donc que ces problèmes soient un peu plus gérables à l’échelon national (ou à des échelons infranationaux) (voir, par exemple, Kaveira et al., 2011).
Ce que nous appelons aujourd’hui « services écosystémiques » est évidemment peut-être déjà en grande partie inclus dans les comptes nationaux. C’est un point que souligne la Banque mondiale (2010). On peut citer par exemple à ce propos les services de pollinisation naturelle qui (de fait) sont capitalisés dans la valeur des terres agricoles, ou les services récréatifs qui sont (implicitement et en partie) fournis par certains espaces naturels. Dans cette optique, les écosystèmes soutiennent les activités marchandes de différentes façons importantes (mais indirectes), et la difficulté en termes de comptabilité est de réattribuer correctement la valeur de tel ou tel service à l’actif (écosystème) qui en est à l’origine (Nordhaus, 2006).
Pour autant que les services écosystémiques n’apparaissent nulle part dans les comptes, ils seront évidemment ignorés si la méthode comptable utilisée repose uniquement sur la réattribution de valeurs1. De nombreux types de services culturels, par exemple, peuvent ainsi échapper à toute prise en compte. Néanmoins, commencer par identifier ce qui est déjà couvert (sous une forme ou une autre) dans les comptes nationaux n’est pas sans intérêt. Vu, en particulier, l’opposition traditionnelle des spécialistes de la comptabilité nationale à l’emploi de techniques d’évaluation non marchande (Hecht, 2008 ; de Haan et van de Ven, 2007), il est avantageux d’un point de vue stratégique de commencer par là.
← 1. Vanoli (2015) proposes an approach that integrates a measurement of the deterioration of ecosystems in the national accounts.
La difficulté de l’évaluation du capital naturel ne se limite pas aux progrès des techniques de mesure des valeurs environnementales. Les recommandations relatives aux taux d’actualisation sont également importantes pour la capitalisation des services actuels dans le cadre de l’estimation d’effets qui – compte tenu de la longévité potentielle du capital naturel renouvelable – se matérialisent dans un avenir lointain. Par conséquent, les débats relatifs au niveau du taux d’actualisation – et à la structure par terme des coefficients d’actualisation qui en résulte – ont également de l’importance en l’occurrence, si la « tyrannie de l’actualisation » ne conduit pas à évacuer d’emblée les conséquences futures des interventions actuelles (voir le chapitre 8).
L’évaluation du capital naturel ne se limite cependant probablement pas à une simple capitalisation des flux de services actuels. Comme le montrent Fenichel et Abbott (2014), déterminer la valeur d’un actif écosystémique (ou, plus généralement, du capital naturel renouvelable) exige l’estimation de toute une gamme de paramètres, dont la valeur du flux de services écosystémiques ne constitue qu’un élément. Premièrement, s’agissant d’un actif renouvelable (ou qui se régénère), la productivité de cette ressource persistante doit être prise en compte dans l’actualisation de la valeur (future) de cet actif. Deuxièmement, il existe un gain en capital ou un gain de détention, qualifié par Irwin et al. (2016) d’« effet de rareté », lié au fait de détenir la dernière unité (ou unité marginale) de l’actif considéré.
Autrement dit, le prix de l’actif peut être exprimé sous la forme de l’équation  ,
,
où V désigne la valeur du flux de services (actuel) de l’actif par unité marginale et r le taux d’actualisation. Au dénominateur, le terme  , qui désigne la productivité (nette) de la ressource considérée, est utilisé pour calculer le taux d’actualisation effectif. Au numérateur, le terme
, qui désigne la productivité (nette) de la ressource considérée, est utilisé pour calculer le taux d’actualisation effectif. Au numérateur, le terme  se rapporte à l’« effet de rareté » lié à la détention de la dernière unité de l’actif considéré. Cela laisse donc à penser (suivant l’importance des termes
se rapporte à l’« effet de rareté » lié à la détention de la dernière unité de l’actif considéré. Cela laisse donc à penser (suivant l’importance des termes  et
et  ) que l’approche simple – c’est-à-dire la capitalisation des services actuels – laisse de côté un élément important. Cela peut être lourd de conséquences pour la prise en compte de la valeur des actifs constitutifs du capital naturel, ainsi que de la dégradation ou de l’amélioration de ces actifs.
) que l’approche simple – c’est-à-dire la capitalisation des services actuels – laisse de côté un élément important. Cela peut être lourd de conséquences pour la prise en compte de la valeur des actifs constitutifs du capital naturel, ainsi que de la dégradation ou de l’amélioration de ces actifs.
Fenichel et al. (2016) appliquent ce cadre conceptuel pour évaluer en tant qu’actif les eaux souterraines dans les zones rurales du Kansas, aux États-Unis, au cours de période 1996-2005. Le stock d’eau souterraine – la quantité d’eau se trouvant dans une nappe aquifère d’une taille donnée – est défini ici comme le produit de l’épaisseur de la zone saturée (essentiellement composée de roches) et d’une estimation de son rendement. Au cours de la période étudiée, les auteurs parviennent à la conclusion que les eaux souterraines ont été épuisées, en termes physiques, à un rythme de 0.4 % par an. Cela revient cependant à surestimer la variation annuelle correspondante de la valeur économique de ce stock. Cela tient au fait que tandis que le stock diminue, sa valeur marginale augmente en raison d’un « effet de rareté ». Pour l’illustrer, les auteurs montrent que lorsque les eaux souterraines sont rares, la valeur monétaire d’une unité marginale – définie par sa valeur pour l’agriculture – est environ deux fois plus élevée que lorsque les eaux souterraines sont abondantes (autrement dit, lorsque leur quantité physique est environ dix fois supérieure). Pour prendre en compte de manière correcte l’amortissement économique des eaux souterraines au Kansas, il faut mettre en relation ce barème de prix avec différents niveaux d’abondance. Fenichel et al. montrent empiriquement l’importance de cet élément :la valeur économique de la perte subie au niveau du stock d’eau souterraine est de 6.5 % par an au cours de la période considérée.
Un autre type de problème réside dans le fait de savoir comment procéder lorsque l’évaluation d’un stock d’actifs environnementaux doit intégrer des valeurs détenues par des individus dans un avenir lointain. Il est clair que l’on ne peut savoir quelle sera la nature exacte des préférences futures – autrement dit, à quel avenir les individus accorderont de l’importance – au-delà des éléments dont on peut avoir la conviction qu’ils resteront nécessaires en termes de survie ou de fonctionnement élémentaire. Face à cette incertitude, la solution adoptée généralement en pratique consiste à poser l’hypothèse que les individus auront dans l’avenir les mêmes préférences qu’aujourd’hui, tout en revoyant à la hausse ces valeurs de manière à prendre en compte les effets probables de la variation (c’est-à-dire de l’augmentation) du revenu par habitant. Il est moins fréquent de prendre en compte la trajectoire d’évolution probable des actifs naturels : si l’on pense qu’un actif naturel sera plus rare dans l’avenir, il est plausible que la valeur (marginale) attribuée à la diminution future des services découlant de cet actif sera plus élevée (qu’aujourd’hui).
Une autre question (connexe) est de savoir ce qu’il advient de ces valeurs lorsque l’actif sous-jacent est difficile à remplacer. Dans l’exemple précédent tiré de Fenichel et al. (2015), l’estimation de l’effet de rareté relatif aux eaux souterraines peut s’expliquer par les caractéristiques des ressources, qui tendent à être localisées et peu substituables. Gerlagh et van der Zwann (2002) examinent le cas de figure général où ces possibilités de substitution sont fonction du stock d’actif lui-même. Autrement dit, lorsqu’une ressource comme un écosystème est relativement abondante, les pertes de cet actif « ne comptent pas », au sens où cette source de bien-être pourrait être aisément remplacée par quelque chose d’autre sans que la situation des individus s’en trouve fondamentalement dégradée. Néanmoins, au-delà d’un certain seuil, les possibilités de substitution diminuent rapidement. En d’autres termes, la diminution persistante du stock d’actif naturel considéré – au-delà de ce point critique – peut être de moins en moins compensée et, au contraire, renforce la perspective que les effets négatifs sur le bien-être futur ne cessent de croître tandis que l’épuisement de la ressource considérée se poursuit1. Les conséquences de cette substituabilité limitée peuvent être complexes. Traeger (2011) montre que cela influe sur le niveau etla structure par terme des taux d’actualisation sociaux (voir le chapitre 8). Le point essentiel demeure qu’un manque de possibilités de substitution devrait se traduire par une augmentation correspondante de la valeur (marginale) devant être attribuée au capital naturel en cas de destruction ou de dégradation de ce capital.
Ces questions essentielles concernant la substituabilité sont également explorées dans les travaux de Hoel et Sterner (2007) ainsi que de Sterner et Persson (2008). Ces deux études montrent que la valeur (ou le prix fictif) d’une aménité environnementale rare peut augmenter dans le temps. Un paramètre clé utilisé à cet égard correspond à la facilité (ou la difficulté) avec laquelle des actifs naturels particuliers peuvent être remplacés, autrement dit leur « élasticité de substitution ». Plus la valeur de cette élasticité est élevée (indiquant qu’il est plus difficile de remplacer un actif naturel par un autre type de richesse), plus rapide est l’augmentation du prix de l’aménité environnementale considérée au fur et à mesure que l’actif naturel (qui est à l’origine de cette aménité) se raréfie.
L’utilisation de ces connaissances aux fins d’analyses pratiques exige de poser un certain nombre d’hypothèses, tout particulièrement à propos de l’élasticité de substitution. Néanmoins, de sérieux problèmes peuvent apparaître, par exemple, pour l’évaluation des perspectives futures sur la base de « prix durables », c’est-à-dire de prix compatibles avec une trajectoire de développement durable (ce qui n’est pas la même chose que le fait de corriger les prix afin de tenir compte des défaillances actuelles du marché ou d’autres facteurs). Le point important ici est qu’il peut exister un problème de durabilité que l’évaluation au niveau du projet considéré, ou même au niveau global, ne permettra pas de cerner. En principe, une ACA classique pourrait remédier à ces problèmes. Néanmoins, en pratique, cela peut s’avérer extrêmement difficile, et il peut être nécessaire de traiter ces mêmes problèmes de manière assez différente dans le cadre d’une évaluation économique.
12.5. ACA et durabilité (forte)
Cette question de substituabilité limitée (ou inexistante) entre le capital naturel et d’autres actifs est lourde de conséquences pour les règles relatives à la durabilité du développement, ainsi que pour la façon dont une ACA peut être réalisée ou interprétée. La difficulté réside en partie dans l’analyse de ce qui se passe lorsque des actifs complexes, tels qu’un capital naturel renouvelable, changent en raison d’interventions des pouvoirs publics. On peut citer à titre d’exemple le concept de « résilience écologique », qui peut caractériser le capital écologique (Mäler et al., 2009 ; Mäler, 2008) et désigne la capacité d’un écosystème à résister à des tensions et des chocs (tout en continuant à fournir des services)2. Walker et al. (2010) ont étudié la valeur de ce type de résilience pour l’agriculture dans le sud-est de l’Australie en relation avec la préservation d’une nappe phréatique non salée (principalement dans un contexte de déboisement effectué par des agriculteurs pour étendre leurs exploitations). Dans ce cas, l’expansion de l’agriculture contribue à épuiser le stock de sols non salins (mesuré à partir de la profondeur des sols épargnés par l’invasion saline). Au fur et à mesure que ce facteur d’épuisement s’aggrave, le stock de résilience écologique diminue. Le processusd’épuisement pouvant lui-même générer des avantages (ici en termes de production agricole), il est nécessaire d’évaluer les avantages tirés de l’épuisement de la ressource considérée en les mettant en balance avec le fait que les pertes de résilience devront être compensées si le stock descend au-dessous d’un certain seuil. Le franchissement de ce seuil débouchera toutefois sur des pertes probablement irréversibles de productivité agricole (en raison des sols salins), si bien que cette résilience a une valeur spécifique qui devrait être intégrée dans toute évaluation économique des interventions rapprochant ou éloignant ce système du seuil considéré.
Un autre problème tient à la non-linéarité de certains processus. Au terme d’une analyse coûts-avantages ne tenant pas compte des seuils, par exemple, il pourrait être recommandé de convertir en partie un écosystème, ou d’autres éléments, pour qu’il puisse être utilisé de manière plus directe par l’homme. Cela pourrait cependant reposer sur l’hypothèse que la conversion de cette partie de l’écosystème serait sans incidence sur les autres services fournis par ce même écosystème. Or, compte tenu de la non-linéarité de certains processus, cette hypothèse pourrait être sujette à caution. En l’occurrence, la véritable difficulté réside dans les liens d’interdépendance existant entre les divers services fournis par l’écosystème en question. En termes d’évaluation des actifs, cela signifie que la valeur économique d’un service donné peut dépendre de ses relations avec les autres services. L’évaluation des actifs concerne les évolutions de l’écosystème, qui sont elles-mêmes dépendantes de la façon dont tout évolue, et non uniquement le service sur lequel souhaiterait se focaliser le praticien.
Il s’agit d’ailleurs d’une autre raison pour laquelle il n’est pas possible d’estimer la valeur « totale » – si, disons, l’on réduit considérablement l’écosystème, tout changera. Toutefois, le point crucial réside ici dans le fait que la zone écologique considérée est un « système ». Les écosystèmes se caractérisent en effet par des processus interactifs et une capacité variable d’adaptation aux changements exogènes, sachant que les changements en question sont souvent non linéaires (Arrow et al., 2000). Si tel est le cas, il faudrait les gérer en conséquence sous l’angle de l’action publique, ce qui pourrait influer sur la façon dont l’ACA contribue à étayer les choix effectués en termes de gestion. Point important, il n’est pas évident que les approches « ascendantes » (marginales), suivant lesquelles on estime séparément la valeur de chaque type de service puis on ajoute ces valeurs pour avoir une idée de la valeur totale d’un écosystème, permettent d’appréhender la valeur « globale » de l’écosystème étudié. Autrement dit, il est possible que la valeur d’un écosystème considéré dans son ensemble soit supérieure à celle de la somme de ses composantes. La méthode d’évaluation ascendante des actifs risque donc d’induire en erreur. La faible valeur économique d’unservice donné pourrait laisser supposer qu’il est possible de s’en passer. Or, sa suppression pourrait avoir des répercussions sur les autres services du fait de transformations complexes au sein de l’écosystème considéré.
Un autre problème tient au fait qu’il n’existe pas seulement une incertitude quant à la nature des services eux-mêmes, mais aussi et surtout en ce qui concerne leurs interactions. Nombre d’observateurs s’accordent à considérer que le capital naturel, notamment les actifs écosystémiques, se caractérise par des seuils, mais une plus grande incertitude prévaut quant au niveau de ces seuils, en particulier dans l’optique pratique de les intégrer dans des mécanismes d’élaboration des politiques publiques comme l’ACA. L’exemple susmentionné des terres agricoles non salines dans le sud-est de l’Australie constitue donc une exception à la règle, au regard des connaissances empiriques dont on dispose. De même, la non-linéarité de certains processus peut signifier que même la perte de fractions modestes d’un écosystème peut être lourde de conséquences (dès lors qu’on se rapproche d’un seuil ou qu’on le franchit, ou qu’il existe des interactions avec d’autres composantes du système considéré).
La conversion d’un système naturel peut donc avoir des effets imprévus et préjudiciables, qui risquent d’être irréversibles. Les efforts d’évaluation de ces changements dans le cadre d’une ACA restent importants, mais il convient de reconnaître qu’il est peu probable qu’ils nous éclairent beaucoup sur l’ampleur des changements « tolérables ». Qui plus est, si des décisions sont prises et qu’elles s’avèrent extrêmement coûteuses, il n’est guère possible de revenir en arrière. Les pertes d’actifs constitutifs du capital naturel peuvent correspondre à la conjonction de plusieurs éléments : effet « d’échelle » potentiellement important, irréversibilité et incertitude. Certains considèrent que la combinaison de ces éléments de « durabilité forte » justifie de partir du principe qu’il faut préserver le capital naturel (et ses composantes). Suivant cette logique, il est également nécessaire d’adopter une approche assez différente en termes d’utilisation de l’ACA pour prendre des décisions en matière d’investissement et d’action publique.
12.6. Analyse coûts-avantages et principe de précaution
Les économistes savent de longue date que cette conjonction de facteurs milite fortement en faveur de l’application du « principe de précaution » pour la prise de décisions (voir, par exemple, Dasgupta, 1982). On a vu aux chapitres 9 et 10 qu’il existe deux approches pour réaliser une ACA. La première – la plus courante – s’applique aux cas de faible incertitude ou lorsque celle-ci est telle que la décision appropriée pourrait être prise sur la base des valeurs escomptées. La seconde tient davantage compte de l’incertitude et prend expressément en considération l’irréversibilité de certains facteurs, soit parce que les fonds engagés ne peuvent être « désengagés », soit parce que d’autres effets de la politique considérée ne peuvent être inversés (ou pour ces deux raisons). Elle correspond à l’approche de l’ACA dite des « options réelles ».
Dans le cadre de cette approche des options réelles, une attention considérable est accordée à la possibilité d’en apprendre davantage, et donc de réduire l’incertitude, en reportant les décisions irréversibles. Il paraît clair que les nombreuses dimensions de la question du capital naturel (en particulier celle de l’évolution des écosystèmes) peuvent être appréhendées au moyen de cette approche : le sujet se caractérise par une incertitude, une irréversibilité et une forte probabilité d’en apprendre davantage grâce aux progrès scientifiques qui permettent une meilleure compréhension du mode de fonctionnement des actifs naturels et de leur comportement. C’est en ce sens que l’approche des options réelles donne un contenu rigoureux à une notion comme le « principe de précaution ». Il convient de noter que cette interprétation du principe de précaution imposerait de se montrer nettement plus prudent face au risque de perte d’écosystèmes, mais les coûts et les avantages n’en seraient pas moins mis en balance.
Une autre approche, celle des « normes minimales de sécurité », est également envisageable pour donner corps au principe de précaution (Ciriacy-Wantrup, 1968 ; Bishop, 1978 et Randall, 2014). Suivant cette approche, la conversion ou à la perte d’un capital naturel ne serait pas admise à moins que les coûts d’opportunité – c’est-à-dire la valeur du « développement » auquel il faudrait renoncer – ne soient d’une ampleur intolérable. Cette approche renverse de fait la « charge de la preuve », puisqu’on ne part plus du principe que le développement est justifié sauf si les coûts pour l’environnement s’avèrent très élevés, et que l’on présume au contraire que la conservation du capital naturel constitue l’option appropriée à moins que ses coûts d’opportunité ne soient très importants. Il n’est toutefois pas aisé de déterminer ce que l’on entend par « coûts intolérables ». Ceux-ci pourraient de fait être définis dans le cadre d’un processus politique, par rapport à un niveau de référence théorique – tel qu’un certain pourcentage du produit national brut (PNB) – ou sur la base d’un critère plus extrême – consistant, par exemple, à se demander si renoncer au développement déboucherait sur de graves difficultés ou une situationd’extrême pauvreté.
Le principe de précaution – pour les raisons exposées dans la précédente section et peut-être en se fondant sur un raisonnement éthique et/ou un cadre de prise de décisions tel que celui des normes minimales de sécurité – milite à son tour en faveur de l’application d’un principe de durabilité forte, suivant lequel aucune nouvelle dégradation ou perte de capital naturel ne devrait être tolérée. Prendre en compte les informations scientifiques sur les seuils constitue alors une des façons d’aborder ces contraintes de durabilité. L’incertitude qui prévaut quant au niveau de ces seuils peut cependant poser problème. La question de savoir si cela vaut pour le capital naturel dans son ensemble (à supposer qu’il existe une base d’agrégation), ou uniquement pour certaines catégories d’actifs naturels jugés critiques à partir de critères de durabilité forte, reste cependant sujette à débat. On observe toutefois une tendance à privilégier la seconde option, en particulier pour des écosystèmes tels que des grandes catégories d’habitat. Sur le plan pratique, cela a plusieurs conséquences pour l’ACA. Poussée à l’extrême, cette logique pourrait conduire à la conclusion qu’aucun écosystème existant ne devrait être dégradé. Sous une forme moins radicale, elle pourrait se traduire par l’idée que toute perte doit être compensée par la création d’un actif similaire.
12.6.1. Circonscrire l’ACA : l’exemple de la « compensation biodiversité »
Diverses études, à commencer par celle de Barbier et al. (1990), ont cherché à modéliser l’idée de durabilité forte en tant que contrainte aux fins de l’ACA, pour les raisons exposées précédemment dans ce chapitre. Bien que ces travaux soient en grande partie de nature théorique, on observe un intérêt croissant d’ordre pratique pour l’application du principe de compensation des pertes de ressources, par exemple, lors de l’évaluation d’exemples concrets de dommages occasionnés, notamment à des écosystèmes (même si l’applicabilité de ce principe ne leur est pas nécessairement limitée). L’approche fondamentale adoptée, en théorie comme en pratique, consiste à reconnaître que le concept de durabilité forte est particulièrement pertinent pour la gestion d’un portefeuille de projets. Autrement dit, il serait probablement excessif d’exiger qu’aucun des projets retenus lors d’une procédure de sélection ne porte préjudice à un écosystème (dans la mesure où l’on peut supposer que très peu de projets procureraient des avantages nets en ne causant absolument aucun dommage à l’écosystème considéré).
Il existe des formules plus souples de sélection des projets et des options envisageables en matière d’interventions publiques sous une contrainte de durabilité (forte). Elles reposent généralement sur le principe que l’« effet net » sur les écosystèmes d’un portefeuille de projets ou d’interventions publiques doit être au moins nul. Laissons momentanément de côté la question de savoir ce que les projets devraient au juste viser à préserver (globalement) pour examiner les grands principes sur lesquels reposent les approches appliquées, par exemple par Barbier et al. (1990) puis ultérieurement par Pires (1998), en vue d’assortir d’une contrainte de durabilité (forte) les analyses coûts-avantages.
Un exemple pratique de cette contrainte d’investissement remonte quasiment à la naissance de ces idées théoriques. Il part du présupposé que les limites auxquelles se heurtent l’évaluation des actifs signifient que certaines composantes du capital naturel (notamment la « biodiversité », mais pas uniquement) doivent être intégrées à l’ACA en tant que contraintes (de durabilité) (pour une analyse des problèmes pratiques d’évaluation de la biodiversité dans la méthode officielle d’ACA en France, voir par exemple Quinet et al., 2013). L’attention s’est focalisée plus récemment sur la forme que devraient prendre ces contraintes, l’accent étant notamment mis sur les seuils et les limites (de sécurité). Cela exige de connaître ou d’apprécier ces seuils pour différents actifs naturels. Un autre exemple réside dans le changement climatique mondial. L’analyse économique (et, dans ce contexte, l’ACA) a été utilisée pour circonscrire les débats sur ce que devrait être le niveau d’ambition adéquat des politiques climatiques mondiales (voir, par exemple, Stern, 2007 ; Weitzman, 2007). Cependant, ces débats politiques concernant les objectifs climatiques mondiaux ont surtout reposé sur des appréciations du degré de réchauffement qui pourrait être « toléré » sans franchir certains seuils physiques (voir par exemple Rockström et al.,2009 ; Steffen et al., 2015).
Sur le plan pratique, la mise en application de cette approche dans des situations réelles suivant le modèle de la « compensation biodiversité » a constitué une évolution notable. Comme dans les précédents travaux, dont les auteurs considéraient que le principe de durabilité devait s’appliquer à un portefeuille de projets et se traduire par des propositions de compensation, la « compensation biodiversité » repose sur l’idée qu’il faut – globalement – préserver (ou renforcer) la biodiversité en exigeant que toute dégradation ou destruction d’un écosystème ou atteinte à la biodiversité due à un projet soit « contrebalancée » ailleurs par l’amélioration d’écosystèmes existants ou par des apports de biodiversité, sous forme de projets compensatoires. Généralement, toutefois, les effets négatifs induits dans ce contexte sont censés être évités ou, à tout le moins, réduits au minimum sur le site initial. Ce sont les dommages résiduels qui font l’objet d’investissements compensatoires ailleurs (voir, par exemple, Chevassus-au-Louis et al., 2009).
L’approche de la compensation des pertes de ressources rend toujours possibles certains arbitrages entre coûts et avantages, mais il est clair qu’elle circonscrit fortement l’analyse coûts-avantages. Roach et Wade (2006) ont étudié empiriquement, dans le contexte des habitats, les systèmes de compensation des pertes de ressources ou d’« équivalence ». En pratique, comme indiqué précédemment, ils prennent la forme d’outils d’intervention aux noms divers : « banques de compensation », « création d’habitats de réserve », « équivalence ressource-ressource » (REMEDE, 2008) ou « compensation biodiversité ». L’engagement d’intensifier le recours à de tels outils figure d’ailleurs dans les Objectifs d’Aichi (qui s’inscrivent dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique), la stratégie de l’Union européenne en faveur de la biodiversité à l’horizon 2020 et le livre blanc sur le milieu naturel du Royaume-Uni (Defra, 2011). Le Programme de compensation pour les entreprises et la biodiversité (BBOP, Business and Biodiversity Offsets Programme) définit la compensation biodiversité comme les « résultats mesurables obtenus en termes de préservation de la biodiversité après la mise en œuvre de mesures destinées à compenser les effets négatifs résiduels importants d’un projetdonné sur la biodiversité qui subsistent après l’adoption de mesures appropriées de prévention et d’atténuation » (BBOP, 2012, p. 12).
Toujours selon le BBOP, le but de ces interventions est d’« éviter toute perte nette, en obtenant de préférence un gain net […] du point de vue de la composition des espèces, de la structure des habitats, des fonctions des écosystèmes et de leur utilisation par la population, et des valeurs culturelles associées à la biodiversité » (BBOP, 2012, p. 13). L’éventail des attributs à prendre en compte aux fins des mesures de compensation est donc très large. Comme on pouvait s’y attendre, en pratique, les dispositifs de compensation biodiversité n’ont pas été à la hauteur de ces ambitions, et se sont souvent appuyés au contraire sur des mesures assez simples de l’étendue et de la qualité des habitats. Cela a suscité des débats sur la question de savoir si la compensation assure une véritable « équivalence » (et sur les moyens de mieux la garantir), ainsi que sur d’autres questions comme la gouvernance, l’additionnalité et les fuites (voir, par exemple, Bull et al., 2013 ; Gardner et al., 2013 ; POST, 2011).
L’intérêt de la compensation biodiversité est qu’elle soumet l’ACA à une contrainte stratégique. En d’autres termes, une fois connue la contrainte, les règles d’évaluation des coûts et des avantages deviennent assez simples, au moins en principe : l’ACA doit s’inscrire dans de ce cadre, la règle de décision étant de maximiser les avantages nets en respectant la contrainte. Inutile de dire que cela peut soulever un certain nombre de questions. Par exemple, ce type de contrainte constitue-t-il un cas à part ou relève-t-il de considérations stratégiques plus générales ? Et comment déterminer cette contrainte ?
En ce qui concerne cette dernière question, compte tenu des caractéristiques de la durabilité forte, l’apport des sciences naturelles sur la part de la nature à conserver est évidemment crucial. Certaines considérations sociales ont sans doute également un rôle à jouer, ne serait-ce que pour l’élaboration d’un avis technique sur ce qui est jugé politiquement possible. Il importe aussi de se demander dans quelle mesure cette analyse économique, en particulier l’évaluation des coûts et des avantages, doit servir à déterminer la contrainte stratégique. Les considérations de coûts et d’avantages ne peuvent avoir la primauté, sachant que la contrainte de durabilité forte démontre précisément leurs limites. Reste que ces considérations ne sont pas non plus sans pertinence. Des principes directeurs comme les normes minimales de sécurité peuvent aider à trouver un juste équilibre à cet égard.
Une autre façon d’appréhender ces débats consiste cependant à reconnaître qu’ils correspondent à des « systèmes de croyances » différents, jugés cruciaux pour les questions d’action publique. Dans cette optique, l’ACA constitue elle-même un système de croyances reposant sur l’idée qu’il importe d’expliciter les conséquences des choix effectués par les pouvoirs publics quant à l’utilisation des ressources économiques et, en particulier, les arbitrages qui en découlent. D’autres systèmes de croyances pourraient tout à fait rejeter de tels arbitrages, peut-être en donnant la priorité à la protection de la nature pour des raisons éthiques particulières. Plutôt que de rejeter purement et simplement l’ACA, adopter l’approche des « contraintes de durabilité » permet d’examiner utilement les implications de ces différentes croyances. Surtout, elle permet d’expliciter les coûts (ainsi que les avantages) résultant du respect de ces contraintes.
La compensation biodiversité est une contrainte spécifique, mais qui, appliquée à bon escient et de manière systématique, peut avoir une portée considérable. Cela vaut également pour la compensation des émissions de carbone. Cependant, la durabilité forte englobe manifestement un ensemble plus large de préoccupations relatives à la nature et au capital naturel en général. On peut donc raisonnablement se demander si de telles contraintes constituent des cas particuliers, ou quelque chose de plus répandu, et quel devrait être le caractère de ces contraintes. Dans son esprit, l’approche de durabilité forte laisse assurément entrevoir un rôle plus systématique pour la fixation de contraintes stratégiques. À cet égard, Chevassus-au-Louis et al. (2009), par exemple, suggèrent d’établir une distinction entre le capital naturel qui a une valeur « intrinsèque » et celui qui n’en a pas. Cela passe par des délibérations pratiques sur les caractéristiques qui permettraient de classer les différents types de ressources dans l’une ou l’autre de ces deux catégories.
Lorsque l’imposition de contraintes est préconisée, déterminer la forme qu’elles devront prendre est une autre affaire. On pourrait envisager une série de contraintes (disparates) correspondant à des actifs naturels spécifiques (biodiversité, carbone, qualité de l’air urbain, etc.). À l’inverse, le capital naturel pourrait être défini de manière globale (voir, par exemple, Helm, 2015). Cela permettrait une flexibilité beaucoup plus grande, mais soulèverait inévitablement la question de savoir si certaines composantes du portefeuille d’actifs naturels sont substituables ou non. Cela exigerait aussi de disposer d’un indice du capital naturel apte en principe à refléter ces arbitrages.
Enfin, étant donné que de fortes contraintes de durabilité – telles que celles inhérentes à la compensation biodiversité – nécessitent une compensation effective, veiller à ce que les investissements correspondants soient vraiment réalisés constitue un autre enjeu. La réponse à cette question ne peut être véritablement apportée que par une évaluation ex post, mais la prise en compte d’un certain nombre de facteurs ex ante pourrait contribuer à atténuer le risque d’échec des projets compensatoires. Ainsi, le Commissariat général au développement durable (CGDD, 2015) identifie divers facteurs de ce type liés aux aspects techniques de la planification et de l’exécution des projets, ainsi qu’aux dispositions institutionnelles qui régissent ces mesures compensatoires. Pour ce faire, il classe par catégorie les risques inhérents aux projets compensatoires, liés par exemple au fait de savoir s’ils permettent ou non la restauration de quantités biophysiques suffisantes (définies à partir d’indicateurs spécifiques, choisis de manière adéquate). En outre, la question de l’endroit où s’effectue la restauration – dans le cadre du projet compensatoire – par rapport aux pertes découlant du projet initial (source d’épuisement du capital naturel) peut aussi avoir son importance : on peut se demander, par exemple, s’il existe des liens entre la premièreet d’autres écosystèmes (connexes).
Compte tenu de ce qui précède, on peut penser qu’une sorte de planification structurée s’impose pour satisfaire ce besoin d’appliquer des contraintes de durabilité aux décisions relatives aux projets et aux interventions publiques. Autrement dit, les dispositions institutionnelles revêtent une importance cruciale. Le Commissariat général au développement durable (CGDD, 2015) souligne que prêter attention à la gouvernance peut aussi permettre d’anticiper les risques d’échec des projets compensatoires en traitant également la question d’autres risques. Cela implique de gérer l’incertitude inhérente aux projets de manière générale, ainsi que de vérifier que les plans de gestion et les ressources économiques nécessaires à la gestion à long terme des écosystèmes sont eux-mêmes durables. En conséquence, il convient de s’assurer d’abord que les budgets et les fonds de réserve sont suffisants puis que leur gestion est confiée aux bons organismes.
12.7. Remarques finales
La notion de « développement durable » occupe désormais une large place dans le débat public et dans le discours des décideurs sur les problèmes d’environnement. Bien que les caractéristiques que doit avoir le développement pour pouvoir être qualifié de durable demeurent un sujet de controverse, nous disposons à présent d’un ensemble cohérent de travaux théoriques, dont les auteurs se sont efforcés de déterminer à quoi pourrait ressembler une trajectoire de développement durable, comment elle pourrait être concrétisée, et comment pourraient être mesurés les progrès accomplis dans ce sens. Ces efforts n’ont pas abouti à un consensus, ce qui n’est guère surprenant, mais ils ont permis de réaliser des progrès considérables dans la compréhension des points d’accord et de désaccord, ainsi que des raisons de leur existence. Les objectifs de développement durable (ODD) adoptés par les Nations unies constituent peut-être l’exemple le plus marquant de l’accession de la durabilité au rang de priorité des pouvoirs publics.
Dans la plupart de ces travaux, l’obtention d’un développement durable est considérée comme un objectif d’ordre général ou de nature macroéconomique. Dans l’ensemble, les spécialistes de l’analyse coûts-avantages n’ont pas activement cherché à s’impliquer dans ce débat plus vaste, sauf lorsqu’il porte sur des facteurs ayant une incidence sur les avantages nets ou le taux de rendement escomptés d’un projet. Il convient néanmoins de noter que les récentes évolutions examinées ailleurs dans le présent ouvrage – et plus particulièrement celles qui concernent l’évaluation des impacts sur l’environnement ou encore l’actualisation des coûts et des avantages – ne sont pas sans rapport avec cette question. Dans ce chapitre, nous avons examiné un certain nombre d’hypothèses supplémentaires concernant la possibilité d’élargir le champ de l’analyse coûts-avantages pour tenir compte des récentes préoccupations relatives au développement durable.
Selon une première approche, l’évaluation des projets à la lumière de ces préoccupations aurait à l’évidence un rôle à jouer. Le concept de durabilité forte repose en effet sur l’idée que certains actifs naturels sont si importants ou critiques (pour les générations futures, et peut-être actuelles) qu’il est justifié de les protéger en vue de maintenir leur stock au niveau actuel ou au-dessus de quelque autre niveau retenu comme objectif. Si l’on ne peut escompter que les préférences individuelles en reflètent pleinement l’importance, les décideurs doivent assumer un rôle paternel pour garantir la protection de ces actifs. Certains se sont efforcés de définir cette perspective en se fondant sur des critères écologiques, alors que d’autres se sont appuyés sur des précédents politiques ou considèrent qu’elle exige de privilégier très nettement le principe de précaution dans le cadre de la prise de décisions. Cela soulève d’importantes questions. En effet, éviter que des ressources (potentiellement) critiques subissent des dommages non seulement regrettables mais aussi irréversibles présente certes des avantages, mais l’application de la méthode des projets compensatoires s’accompagne de coûts d’opportunité qui restent à étudier.
S’agissant de l’intérêt de cette approche pour l’analyse coûts-avantages, quelques études ont préconisé l’application du concept de durabilité à la gestion d’un portefeuille de projets. Cela a débouché sur l’idée de projets compensatoires. Suivant cette logique, les projets portant préjudice à l’environnement pourraient, par exemple, être « contrebalancés » par des projets à l’origine d’améliorations de l’environnement. En conséquence, les projets faisant partie d’un même portefeuille assureraient, globalement, un maintien du statu quo sous l’angle de l’environnement. Les applications pratiques de cette approche pourraient inclure des mesures de compensation biodiversité.
Le problème du développement durable peut également être envisagé sous d’autres angles. La question de savoir si ces autres approches – qui sont généralement regroupées sous l’appellation de « durabilité faible » – sont complémentaires ou antagoniques est sujette à débat. Celui-ci s’éteindrait dans une large mesure de lui-même s’il était possible de déterminer quels sont les actifs critiques. Cette dernière question constituant elle-même toutefois une source d’incertitude considérable, comme on l’a vu plus haut, ce débat se poursuit. La version dite « faible » du développement durable n’en reste pas moins utile pour plusieurs raisons. Bien qu’elle ait été principalement considérée comme un guide pour l’élaboration de comptes nationaux verts (c’est-à-dire de meilleures mesures des revenus, de l’épargne et du patrimoine), la focalisation sur les actifs et sur leur gestion a son pendant dans la réflexion sur l’évaluation des projets. Ainsi, il faudrait peut-être mettre l’accent sur la nécessité de déterminer l’état des stocks de ressources avant la mise en œuvre d’un projet d’intervention et leur état probable à la suite de celle-ci.
Références
Arrow, K.J. et al. (2010), « Sustainability and the Measurement of Wealth », NBER Working Paper, n° 16599, www.nber.org/papers/w16599.
Asheim, G.B. et M.L. Weitzman (2001), « Does NNP Growth Indicate Welfare Improvement », Economics Letters, vol. 73, pp. 233-239.
Banque mondiale (2010), The Changing Wealth of Nations, Banque mondiale, Washington, DC, https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/2252.
Barbier, E., A. Markandya et D.W. Pearce (1990), « Environmental Sustainability and Cost-Benefit Analysis », Environment and Planning A, vol. 22, pp. 1259-1266, https://doi.org/10.1068/a221259.
Barbier, E.B. (2011), Capitalizing on Nature, Cambridge University Press, Cambridge, www.cambridge.org/catalogue/catalogue.asp?isbn=0521189276.
Barbier, E.B. (2009), « Ecosystems as Natural Assets », Foundations and Trends in Microeconomics, vol. 4, n° 8, pp. 611-681, https://doi.org/10.1561/0700000031.
Boyd, J. et S. Banzhaf (2007), « What are ecosystem services? The need for standardized environmental accounting units », Ecological Economics, vol. 63, n° 2-3, pp. 616-626, https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2007.01.002.
Chevassus-au-Louis, B. et al. (2009), Approche économique de la biodiversité et des services liés aux écosystèmes – Contribution à la décision publique, Centre d’analyse stratégique, Collection Rapports et documents, Paris.
CGDD (Commissariat général au développement durable) (2015), Nature et richesse des nations, Service de l’économie, de l’évaluation et de l’intégration du développement durable, Paris.
Chiabai, A. et al. (2011), « Economic Assessment of Forest Ecosystem Services Losses: Costs of Policy Inaction », Environmental and Resource Economics, vol. 50, n° 3, pp. 405-445, https://doi.org/10.1007/s10640-011-9478-6.
CMED (Commission mondiale sur l’environnement et le développement) (1987), Notre avenir à tous, Rapport de la Commission mondiale sur l’environnement et le développement, www.diplomatie.gouv.fr/sites/odyssee-developpement-durable/files/5/rapport_brundtland.pdf.
Dasgupta, P. et K.-G. Mäler (2000), « Net national product, wealth and social well-being », Environment and Development Economics, vol. 5, pp. 69-93, www.cambridge.org/core/product/8819C6F796223EF 600E7F5C339491944.
Dasgupta, P.M. (2009), « The Welfare Economic Theory of Green National Accounts », Environment and Resource Economics, vol. 42, pp. 3-38, https://doi.org/10.1007/s10640-008-9223-y.
Day, B. et D. Maddison (2015), Improving Cost-Benefit Analysis Guidance, Report to the Natural Capital Committee (NCC), NCC, Londres, http://nebula.wsimg.com/ad8539d7216f5e6589bbe625c9750fff? AccessKeyId=68F83A8E994328D64D3D&disposition=0&alloworigin=1.
Dietz, S. et N. Stern (2008), « Why Economic Analysis Supports Strong Action on Climate Change: A Response to the Stern Review’s Critics », Review of Environmental Economics and Policy, vol. 2, n° 1, pp. 94-113, https://doi.org/10.1093/reep/ren001.
Fenichel, E.P. et al. (2016), « Measuring the Value of Groundwater and Other Forms of Natural Capital », PNAS, vol. 113(9), pp. 2382-2387, https://doi.org/10.1073/pnas.1513779113.
Fenichel, E.P. et J.K. Abbott (2014), « Natural capital: From Metaphor to Measurement », Journal of the Association of Environmental and Resource Economists, vol. 1(1), pp. 1-27, https://doi.org/10.1086/676034.
Gerlagh, R. et B.C.C. van der Zwaan (2002), « Long-Term Substitutability between Environmental and Man-made Goods », Journal of Environmental Economics and Management, vol. 44, pp. 329-345, https://doi.org/10.1006/jeem.2001.1205.
Gowdy, J. et al. (2010), « Discounting, Ethics and Options for Maintaining Biodiversity and Ecosystem Integrity », in Kumar, P. (dir. pub.), The Economics of Ecosystems and Biodiversity: Ecological and Economic Foundations, Earthscan, Londres.
Haines-Young, R. et al. (2009), Towards a Common International Classification of Ecosystems (CICES) for Integrated Environmental and Economic Accounting, Report to the European Environment Agency, Copenhague.
Hamilton, K. et E. Ley (2013), « Sustainable Fiscal Policy for Mineral Based Economies », in Amadou, S., A. Rabah et B. Gylfason (dir. pub.), Beyond the Curse: Policies to Harness the Power of Natural Resources, Fonds monétaire international, Washington, DC.
Hamilton, K. et G. Atkinson (2006), Wealth, Wellbeing and Sustainability, Edward Elgar, Cheltenham.
Hamilton, K. et J.M. Hartwick (2014), « Wealth and Sustainability », Oxford Review of Economic Policy, vol. 30, n° 1, pp. 170-187, https://doi.org/10.1093/oxrep/gru006.
Hamilton, K. et M. Clemens (1999), « Genuine Savings Rates in Developing Countries », World Bank Economic Review, vol. 13, n° 2, pp. 333-356, https://doi.org/10.1093/wber/13.2.333.
Hartwick, J.M. (1992), « Deforestation and national accounting », Environmental and Resource Economics, vol. 2, n° 5, pp. 513-521, https://doi.org/10.1007/BF00376832.
Hartwick, J.M. (1977), « Intergenerational equity and the investing of rents from exhaustible resources », American Economic Review, vol. 67, pp. 972-974.
Hoel, M. et T. Sterner (2007), « Discounting and Relative Prices », Climatic Change, vol. 84, n° 3-4, pp. 265-280, https://doi.org/10.1007/s10584-007-9255-2.
Kaveira, P. et al. (dir. pub.) (2011), Natural Capital: Theory and Practice of Mapping Ecosystem Services, Oxford University Press, Oxford.
Krutilla J. et A.C. Fisher (1974), The Economics of Natural Environments, Johns Hopkins University Press, Baltimore.
Mace, G.M., K. Norris et A.H. Fitter (2012), « Biodiversity and Ecosystem Services: A Multilayered Relationship », Trends in Ecology & Evolution, vol. 27, n° 1, pp. 19-26, https://doi.org/10.1016/j.tree.2011.08.006.
Mäler, K.-G. (2008), « Sustainable Development and Resilience in Ecosystems », Environmental and Resource Economics, vol. 39, n° 1, pp. 17-24, https://doi.org/10.1007/s10640-007-9175-7.
Mäler, K.-G. (1991), « National Accounts and Environmental Resources », Environmental and Resource Economics, vol. 1, pp. 1-16.
Mäler, K.-G., S. Aniyar et Å. Jansson (2009), « Accounting for Ecosystems », Environmental and Resource Economics, vol. 42, n° 1, pp. 39-51, https://doi.org/10.1007/s10640-008-9234-8.
Pascual, U. et al. (2010), « Valuation of Ecosystems Services: Methodology and Challenges », in Kumar, P. (dir. pub.) The Economics of Ecosystems and Biodiversity: Ecological and Economic Foundations, Earthscan, Londres.
Pearce, D. W. et G. Atkinson (1993), « Capital Theory and the Measurement of Sustainable Development: An Indicator of ‘Weak’ Sustainability », Ecological Economics, vol. 8, n° 2, pp. 103-108, https://doi.org/10.1016/0921-8009(93)90039-9.
Pezzey, J. (1989), « Economic Analysis of Sustainable Growth and Sustainable Development », Environment Department Working Paper n° 15, Banque mondiale, Washington, DC.
Solow, R.M. (1986), « On the intergenerational allocation of natural resources », Scandinavian Journal of Economics, vol. 88, vol. 1, pp. 141-149, www.jstor.org/stable/3440280.
Solow, R.M. (1974), « Intergenerational Equity and Exhaustible Resources », Review of Economic Studies, vol. 41, pp. 29-45, www.jstor.org/stable/2296370.
Sterner, T. et U.M. Persson (2008), « An Even Sterner Review: Introducing Relative Prices into the Discounting Debate », Review of Environmental Economics and Policy, vol. 2, n° 1, pp. 61-76, https://doi.org/10.1093/reep/rem024.
van der Ploeg, R. (2014), « Guidelines for exploiting natural resource wealth », Oxford Review of Economic Policy, vol. 30, n° 1, pp. 145-169, https://doi.org/10.1093/oxrep/gru008.
Walker, B. et al. (2010), « Incorporating Resilience in the Assessment of Inclusive Wealth: An Example from South East Australia », Environmental and Resource Economics, vol. 45, n° 2, pp. 183-202, https://doi.org/10.1007/s10640-009-9311-7.
Weitzman, M.L. (1976), « On the Welfare Significance of National Product in a Dynamic Economy », Quarterly Journal of Economics, vol. 90, n° 1, pp. 156-162, www.jstor.org/stable/1886092.
Notes
← 1. Gerlagh et van der Zwann (2002) examinent le cas où les individus ont une très forte préférence pour les actifs naturels, plutôt qu’une situation de non-substituabilité en tant que telle. De fortes similitudes apparaissent avec la notion de préférence lexicographique, à laquelle est consacré un pan spécifique des études sur les préférences déclarées. Cette hypothèse implique cependant que la liquidation d’un actif naturel au-delà d’un certain seuil abaisse vraisemblablement le niveau maximum que pourra atteindre le bien-être futur.
← 2. Cette approche permet aussi de prendre en compte un aspect crucial qui est propre aux actifs écosystémiques, à savoir le fait que ces ressources sont soumises à des effets de seuil, de sorte les services qui en découlent sont exposés à un risque (éventuellement) accru de changements abrupts et extrêmes une fois franchi un niveau critique pour l’actif considéré.